Mise à jour 18 Mars 2025.
CONFÉRENCE MENSUELLE
De James LEQUEUX Astronome émérite de l’Observatoire de Paris
« LES EXOPLANÈTES, 30 ANS DE SURPRISES »
Organisée par la SAF
En présence du public et en vidéo (direct) sur canal YouTube SAF
Le Mercredi 12 Mars 2025 à 19H00
Photos : BZ et JPM, pour l'ambiance. (Les photos avec plus de résolution peuvent
m'être demandées directement)
Les photos des slides sont de la présentation de l'auteur. Voir les crédits des
autres photos si nécessaire
La présentation est disponible sur
ma liaison ftp ,
Rentrer le mot de passe, puis aller à CONFÉRENCES SAF ensuite SAISON 2024/2025 ;
Elle s’appelle : Exoplanètes Lequeux SAF.pdf
Ceux qui n'ont pas les mots de passe doivent aussi me
contacter avant..
La conférence disponible est en pdf.
La vidéo de la réunion est accessible à cet URL :
https://youtu.be/8OJW0bSxNUM?list=PL78ug7UrzPF1w8Tv32bQsZtE1Q5Tz7nBP
Tous les autres enregistrements des conférences mensuelles sont accessibles sur
la playlist
des conférences mensuelles d’Astronomie de notre chaine YouTube SAF.
Nous étions plus de 200 dans la salle et 100 à distance sur YouTube. Un beau
succès pour notre conférencier !

Notre amie Brigitte Zanda, du MNHN, est astrophysicienne et grande spécialiste
des météorites.
Elle est aussi membre de la SAF et c’est elle qui dirige cette conférence
aujourd’hui.
Photo : capture d’écran.
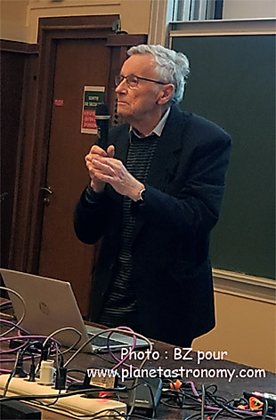
James Lequeux sort de Normal Sup, il a longtemps dirigé la station de Nançay,
puis l’Observatoire de Marseille.
Auteur de nombreux ouvrages il a aussi été le responsable de la revue Astronomy
& Astrophysics.
Il est astronome émérite à l’Observatoire de Paris.
Il vient d’écrie avec sa collègue Thérèse Encrenaz un ouvrage
sur les exoplanètes
dont le titre est le même que celui de sa présentation de ce soir.
James commence par un historique de la notion d’exoplanètes, depuis Épicure, G
Bruno, Fontenelle, jusqu’au début de l’époque moderne vers la fin du XXème
siècle pour arriver à la découverte fondamentale de M Mayor et D Queloz en 1995
avec 51 Peg.
Énorme surprise, c’était une grosse planète tournant très près de son étoile.
Découverte effectuée par la
méthode des vitesses radiales.
Mais c’est David Charbonneau qui découvre la première exoplanète par
la méthode du transit
en 1999.
On s’apercevra vite que c’est une méthode très puissante pour détecter un grand
nombre de ces planètes extra solaires.
Cela donnera naissance aux missions spatiales :
·
Corot Française et
·
Kepler
de la NASA très fructueuse.
Je reprends une explication précédente sur les deux méthodes initiales de
recherche d’exoplanètes :
Comment mettre en évidence une exoplanète ?
Il y a deux difficultés majeures :
· une très faible séparation angulaire
· un contraste de luminosité en revanche énorme.
La première méthode utilisée est celle
des vitesses radiales.
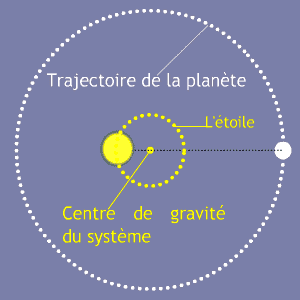 Étoiles
et planètes tournent autour de leur centre de masse commun, qui est légèrement
différent du centre de l'étoile, c'est à dire que l'étoile possède un petit
mouvement décentré autour de ce point.
Étoiles
et planètes tournent autour de leur centre de masse commun, qui est légèrement
différent du centre de l'étoile, c'est à dire que l'étoile possède un petit
mouvement décentré autour de ce point.
C'est ce mouvement (wobble en anglais), et ses variations de vitesse que l'on
essaie de détecter pour ainsi révéler la présence d'une (ou plusieurs) planètes
autour de cette étoile.
Ce mouvement est illustré sur l'animation gif ci-contre.
C'est ce que l'on appelle la mesure par la méthode des vitesses
radiales (Radial
Velocity en anglais)
Il est clair que l'étoile étant énormément plus massive que l'étoile, son
mouvement autour du centre de masse est très faible, par exemple, pour notre
Soleil, et en ne prenant en compte que Jupiter dans le système solaire, il
serait de l'ordre de 500 microsecondes d'arc, vu d'une distance de 10pc comme
expliqué dans cet article de l'Observatoire de Paris.
Le déplacement dû à une petite planète comme la Terre serait …………1000 fois plus
faible !!!
Hors de portée de nos instruments pour le moment.
De telles différences de vitesse ou de déplacement peuvent être détectés par
effet Doppler, que tout le monde connaît maintenant, c'est par exemple, le cas
de la voiture qui arrive de loin vous dépasse et s'éloigne de vous.
Quand on s'approche les longueurs d'onde diminuent (plus aiguë ou plus bleu) et
quand on s'éloigne, elles augmentent (plus grave ou plus rouge).
Ce déplacement en fréquence (shift en anglais) se détecte sur la lumière émise
par l'étoile autour de son orbite.
Un bel exemple de
déplacement des raies par la présence d'une exoplanète.
L’autre grande méthode : la
méthode du transit.
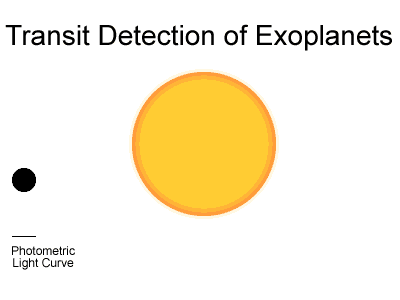 Voici
le principe : une planète (invisible depuis la Terre), passe devant son étoile
régulièrement ; l'éclat de l'étoile diminue légèrement.
Voici
le principe : une planète (invisible depuis la Terre), passe devant son étoile
régulièrement ; l'éclat de l'étoile diminue légèrement.
C'est cet affaiblissement de luminosité que l'on détecte pour affirmer la
présence de la planète.
Une animation du transit d'une planète devant son étoile.
C'est le même genre de phénomène que l'on a observé avec Vénus lors de son
passage devant le Soleil le 8 Juin 2004.
Mais il existe de nouvelles méthodes favorisées par l’évolution technique des
instruments comme :
L’utilisation de
lentilles gravitationnelles.
Un rappel :
La Relativité d’Albert Einstein implique que toute masse courbe l’espace, et
plus la masse est forte, plus la courbure est grande.
Les rayons lumineux passant à proximité d’une telle masse sont déviés ; c’est ce
principe qui permit en 1919 de prouver sa théorie lors d’une éclipse. Dans ce
cas, en 1919, la masse mise en jeu (le Soleil) était relativement petite, les
déviations étaient faibles.
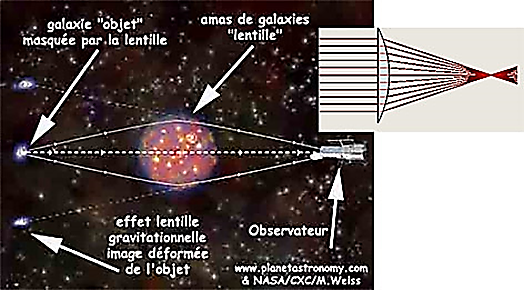
Mais que se passerait-il si un amas de galaxies proche remplaçait le Soleil et
qu’un objet très lointain, une autre galaxie beaucoup plus lointaine par
exemple, soit dans la ligne de visée ?
La masse interposée entre l'observateur et cette galaxie invisible
induit un effet de loupe
et fait apparaître ainsi des images (déformées) de cette galaxie mais dont la
luminosité est amplifiée, et est rendue ainsi visible.
L’effet décrit par Einstein est un effet de lentilles gravitationnelles
(gravitational lens en anglais).
Si l’effet de lentille gravitationnelle permet de détecter des objets très
lumineux, l’effet micro-lentille (micro lensing en anglais) permet d’étudier des
objets
beaucoup moins brillants.
Idéal pour des objets de notre Galaxie par exemple.
Dans cet effet, la masse de la « lentille » est faible ou très faible (étoile,
planète au lieu de galaxies, amas de galaxies).
Crédit : NASA, ESA, and K. Sahu (STScI)
Les étoiles tournent autour du centre galactique dans notre Voie Lactée, et il
peut arriver qu’une étoile ou une planète dans un système extra solaire, passe
devant une étoile lointaine, dans ce cas, il se produit une augmentation de
luminosité lorsque la « lentille » passe devant la source. De plus si la
lentille possède une planète, un
deuxième pic de luminosité
se produit indiquant sa présence.
C’est en 2004 que l’on découvre par cette méthode une exoplanète :
OGLE-2003-BLG-235Lb
Dernière méthode que l’on n’aurait pu imaginer il y dix ans :
l’imagerie directe !!!
En effet les instruments ayant fait de tels énormes progrès (notamment
l’optique adaptative
associée à un coronographe) que l’on peut envisager de VOIR directement des
exoplanètes pas trop éloignées.
Ce fut le cas de
béta Pictoris imagée
en 2003 et 2009.
Crédit ESO/VLT
Le retour de GAIA et de l’astrométrie.
En fait une des missions de Gaia était la découverte d’exoplanètes.
Gaia compare deux régions du ciel distantes de 106,5°.
Comme il balaye lentement tout le ciel, on a de proche en proche la position
relative de toutes les étoiles.
En recommençant on peut mesurer leur déplacement : mouvement propre et
variations périodiques de position dues à une éventuelle planète.
Elle pourrait découvrir quelques dizaines de milliers d’exoplanètes. Il faut
dépouiller les derniers résultats.
En conclusion de cette première partie, voici
le compte actuel des
planètes extra solaires détectées ?
Disponibles sur l’excellent site
https://exoplanet.eu/home/
de J Schneider de Strasbourg.
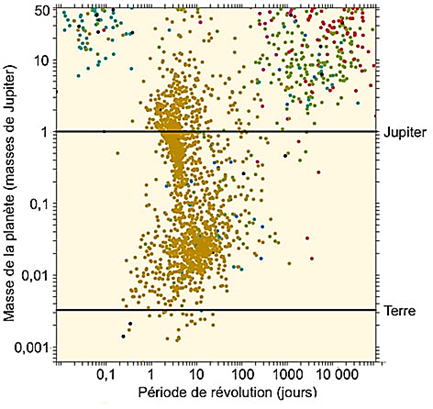 D’après
la slide du conférencier, à ce jour :
D’après
la slide du conférencier, à ce jour :
·
7417 exoplanètes,
·
1035 systèmes multiples
·
1266 par vélocimétrie,
·
4528 par transit, 313 comme lentille gravitationnelle, 202 par astrométrie,
·
1029 par imagerie
Couleurs : marron et bleu : transit ; vert : vitesse radiale ; orange : micro
lentille ; rouge : image directe ; violet : astrométrie.
Crédit : exoplanet.eu.
Les différentes catégories d’exoplanètes.
Il existe une incroyable variété de types d’exoplanètes et de systèmes
exoplanétaires.
Mais apparemment rien de comparable à ce jour à notre système solaire qui
apparait comme une exception.
On trouve principalement des Jupiters chauds ou des super Terres.
Mais peu ou pas de planètes de la taille de la Terre.
Un système particulièrement intéressant : Trappist 1.
Rappel :
Cela se passe dans notre arrière-cour ! À à peine 40 années-lumière de la Terre
; des astrophysiciens Belges de l’Ulg (Université de Liège) et des collègues du
MIT, ont découvert une étoile peu brillante, froide et de la taille de Jupiter
(baptisée TRAPPIST-1, mais son nom complet est moins poétique : 2MASS
J23062928-0502285) autour de laquelle tournent des exoplanètes, dont certaines
seraient dans la zone que l’on considère comme habitable (eau sous ses trois
formes).
Cette étoile se trouve dans le Verseau (Aquarius en anglais).
Rappelons que le télescope TRAPPIST (non ce n’est pas ici une bière fameuse !!)
dont l’acronyme signifie : TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope,
est un télescope IR automatique de 60cm, de nos amis Belges, situé à La Silla au
Chili, il est automatique et dédié à l’étude des transits exoplanétaires pour
étoiles peu lumineuses. Il est contrôlé par les astronomes à partir de la
Belgique.
Ce genre de transits n’est pas détectable à l’aide des autres télescopes
terrestres ou spatiaux car ils sont plutôt axés sur des étoiles beaucoup plus
grosses et lumineuses. Le télescope Trappist est donc axé sur les petites
étoiles (naines brunes) dont les exoplanètes sont plus faciles à détecter.
Rappelons que les naines brunes (approx 100 masses de Jupiter, ce n’est pas
encore une étoile mais ce n’est plus une planète géante) sont les plus
nombreuses mais pas très lumineuses.
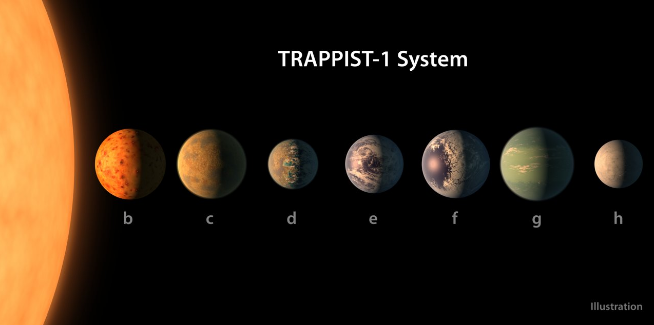 Ces
détections se font bien entendu par la méthode du transit qui a déjà été maintes
fois expliquée ici.
Ces
détections se font bien entendu par la méthode du transit qui a déjà été maintes
fois expliquée ici.
On a d’abord identifié 3 planètes (Trappist 1 b, c et d), qui semblent bien être
de type terrestre.
T 1b a une période de 1,5 jours, donc probablement chaude car si près de son
étoile.
T 1d : on a des doutes sur la période et peu d’infos.
Crédit : NASA/R. Hurt/T. Pyle
Mais la Terre tournant, l’étoile a changé d’hémisphère, on fait donc appel à
Spitzer le télescope spatial IR de la NASA, qui peut l’observer pendant 21
jours.
Et là, surprise, il y a en fait 7 planètes, situées dans un système très
compact.
Si près de leur étoile, elles ont toutes les chances d’être synchrones à cause
des forces de marée puissantes (elles présentent la même face vers l’étoile,
comme la Lune vers la Terre, on dit tidal locked en anglais)
Elles sont toutes en résonance entre elles suivant les rapports : 8 5 3 2 4/3 1
Enfin, on a eu l’idée d’étudier l’atmosphère des exoplanètes.
Mais comment ?
En soustrayant la luminosité durant la seconde éclipse (passage derrière
l’étoile, luminosité de l’étoile seulement) de la luminosité quand la planète
est devant son étoile (luminosité de la planète et de l’étoile), on a été
capable de déterminer la luminosité de la planète. On utilise le spectre en
émission de l’étoile. C’est le transit secondaire.
Et ça marche !
Voir schéma ci-contre.
Crédit : NASA, ESA, CSA, J. Olmsted (STScI), A. Bello-Arufe (JPL)
Exemples de spectres en émission :
55 Cancri-e.
Que savons nous en fait sur ces exoplanètes suite à toutes ces possibilités de
détection ?
Toutes les combinaisons de ces mesures nous permettent d’approcher les
caractéristiques de ces planètes comme :
·
Les différents paramètres orbitaux par vitesse radiale et transit
·
La taille (diamètre) densité et température de surface par photométrie
·
L’atmosphère et sa température et des nuages éventuel par spectro
Et notre conférencier de terminer son exposé par un chapitre sur :
La formation des systèmes planétaires.
Au cours des siècles on a essayé de comprendre la formation de notre Système
Solaire, et jusqu’en 1995, on avait élaboré cette théorie de sa formation : un
nuage de matière et de gaz s’effondre, forme un disque, les petits éléments
s’accrètent par gravité et donne naissance près du Soleil à des petites planètes
solides (les planétésimaux) et plus loin, au-delà de la ligne des glaces, à des
planètes géantes, plus de matière (notamment de la glace) étant à leur
disposition.
C’est ce que l’on pensait avant la découverte par M Mayor et D Queloz de la
première exoplanète, qui ne semblait pas du tout appartenir à ce genre de
structure. On avait en fait une planète géante, chaude et très très près de son
étoile (période orbitale de 4 jours !). Cette planète était du type que l’on
baptisa « Jupiter chaud ».
On ne comprenait pas.
On a donc été obligé de trouver d’autres théories de formation de tels systèmes
solaires.
On aboutit à une théorie où des planètes formées loin de leur étoile, se
rapprochent d’elle par
effet de migration gravitationnelle.
En fait elles vont spiraler vers l’intérieur, ce mouvement étant dû à des «
vagues » provoquées par la présence d’autres planètes.
Les grosses planètes seraient ainsi poussées vers le centre.
Une telle migration se serait aussi produite dans notre Système Solaire.
Application à notre système solaire :
Voilà un schéma qui résume cette incroyable migration de planètes.
En 1 Jupiter jeune se rapproche du Soleil, puis est repoussé vers sa position actuelle, lors de la résonance (R ) avec Saturne (vers les 800 millions d’années) ;
en 2 Saturne jeune, il se forme après Jupiter et grossit aussi et entraîne
Jupiter avant de se retrouver à sa position actuelle.
Se faisant le nouveau couple en se retirant va créer un tohu bohu monstre au
niveau des astéroïdes qui se baladaient vers les 1,5 UA,
vont se regrouper en ceinture et c'est Mars qui va en faire les frais en n'ayant
pas le temps de grossir comme la Terre.
En 5 et 6 Uranus et Neptune sont repoussés vers l’extérieur du système solaire.
Et pour revenir à nos exoplanètes :
ET LA VIE DANS TOUT CELA ?
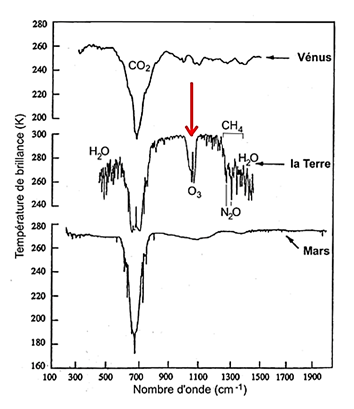
Comment repérer la vie ?
Les traceurs de vie.
Il semble que l’ozone soit un bon candidat.
Le JWST devrait nous aider dans cette recherche.
Illustration : DR
POUR ALLER PLUS LOIN :
Les lentilles gravitationnelles :
CR de la conf SAF par D Valls-Gabaud du 13 Janv 2016.
Exoplanètes et lentilles gravitationnelles :
CR de la conférence IAP d’A. Cassan du 1er Dec 2015
Sommes nous seuls dans l'Univers? :
CR de la conférence d'A. Vidal Madjar à Plaisir le 27 Mars 2010.
Exoplanètes Trappist-1 :
CR de la conf IAP par J Leconte du 8 Janv 2019
A secondary atmosphere on the rocky Exoplanet 55 Cancri e
Extrasolar Planet Detected by Gravitational Microlensing
Chaos dans le syst. Solaire :
CR des conf Vega et SAF (Planeto) de B Lelard les 22 et 29 Avr 2014
Chamboulement dans le système solaire
Le grand bombardement tardif (LHB) par
A Morbidelli, CR sur planetastronomy.com
JWST :.Une
atmosphère autour d’une planète rocheuse
Bon ciel à tous
Prochaine conférence SAF. : le mercredi 9 Avril 2025
(CNAM) 19 H
avec
Ruth DURRER
Astrophysicienne Observatoire de Genève
Prix Janssen 2024
sur « ARPENTER
L’UNIVERS »
Réservation comme d’habitude à
partir du 13 Mars 9h00 ou à la SAF directement.
Transmission en direct sur le canal YouTube de la SAF :
https://www.youtube.com/channel/UCD6H5ugytjb0FM9CGLUn0Xw/feautured
Bon ciel à tous !
Jean Pierre
Martin
Abonnez-vous aux astronews
du site en envoyant votre e-mail.